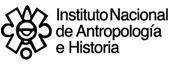

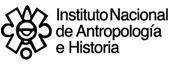

Artículos
Patrimoine, quel enjeu de société?
Conversaciones…
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
ISSN: 2594-0813
ISSN-e: 2395-9479
Périodicité: Bianual
n° 10, 2020

Patrimoine, quel enjeu de société?
Publication originale: Françoise Choay (2011) «Patrimoine, quel enjeu de société?», in: La Terre qui meurt, ©Librairie Arthème Fayard, Paris, pp. 65-99.
Prélude
Le patrimoine dont il sera question ici est constitué par le cadre bâti des sociétés humaines. Synonyme de patrimoine édifié par les hommes, il est, selon ses diverses catégories, qualifié de patrimoine architectural, monumental, urbain, paysager... et, selon son mode d’insertion dans la temporalité, il est dit historique ou contemporain. Dans cette acception spatiale, pris isolément ou assorti de ses diverses qualifications, le vocable «patrimoine» est devenu un mot clé de notre société mondialisée: véhiculé par les instances supranationales et nationales, par les administrations gestionnaires et les praticiens (architectes, urbanistes, etc.), mais aussi par les diverses industries patrimoniales, telles les agences de voyages, et par tous les types de médias qui manipulent les populations de notre globe. Pourtant, malgré un apparent consensus, le contenu de la notion est loin d’être clair.
Importar imagenJe me propose ici de mettre en évidence la valeur symptomatique de cette utilisation du terme «patrimoine». Autrement dit, d’éclairer et de faire comprendre par son intermédiaire les conséquences du processus actuel de globalisation et les dangers qu’il représente pour la survie de notre espèce. À cette fin, j’adopterai une perspective généalogique: je retracerai de façon nécessairement réductrice l’histoire des deux concepts de monument et de monument historique, actuellement confondus et assimilés sous le vocable de «patrimoine1».
La différence et l’opposition entre les notions de monument (sans qualificatif) et de monument historique ont été définies pour la première fois en 1903 par le grand historien de l’art Aloïs Riegl dans l’Introduction du nouveau Projet de législation des monuments historiques élaboré en 1902, sous sa présidence, par la Commission centrale autrichienne des monuments historiques. Le projet global fut publié anonymement en 1903. La même Introduction a été éditée séparément, sous le seul nom de Riegl et sous le titre Der moderne Denkmalkultus (Le Culte moderne des monuments2). Je reprends ici l’analyse de Riegl, mais en tenant compte des recherches accomplies dans le champ des sciences dites humaines depuis la mort de l’historien viennois.
Pour définir le terme «monument», on se reportera à son étymologie. II dérive du substantif latin monumentum, lui-même issu du verbe monere: «avertir», «rappeler à la mémoire». On appellera alors «monument» tout artefact (tombeau, stèle, poteau-totem, bâtiment, inscription...) ou ensemble d’artefacts délibérément conçu et réalisé par une communauté humaine, quelles qu’en soient la nature et les dimensions (de la famille à la nation, du clan à la tribu, de la communauté des croyants à celle de la cité, ...), afin de rappeler à la mémoire vivante, organique et affective de ses membres des personnes, des événements, des croyances, des rites ou des règles sociales constitutifs de son identité.
Le monument se caractérise ainsi par sa fonction identificatoire. Par sa matérialité, il redouble la fonction symbolique du langage dont il pallie la volatilité, et s’avère un dispositif fondamental dans le processus d’institutionnalisation des sociétés humaines. II a pour vocation l’ancrage de celles-ci dans l’espace naturel et culturel, et dans la double temporalité des humains et de la nature.
Ainsi entendu, le monument appelle un vigilant et permanent entretien. Mais il est aussi exposé à une destruction délibérée qui peut prendre deux formes, positive ou négative. On parlera de destruction positive lorsque la communauté concernée laisse tomber ou démolit un monument qui a perdu, complètement ou partiellement, sa valeur mémorielle et identificatoire. En Europe, le plus ancien monument de la chrétienté, la basilique Saint-Pierre de Rome, édifiée par l’empereur Constantin au IVe siècle, a été détruite au XVIe siècle, par décision du pape Jules II, au profit d’une nouvelle basilique, mieux accordée, selon la cour pontificale, à l’évolution de la théologie et du rituel catholiques. Quant à la destruction négative, elle a été pratiquée depuis la nuit des temps par tous les peuples, dans leurs guerres civiles et leurs conflits avec des ennemis extérieurs. Sans compter les destructions non conscientes, opérées sans volonté de nuire par des missionnaires ou des organisations humanitaires3. D’une part, elle peut s’exercer contre leurs ennemis extérieurs, la défaite et l’anéantissement d’une culture s’avérant mieux assurés par la destruction de ses monuments que par la mort de ses guerriers. D’autre part, elle peut sévir à l’intérieur d’une même communauté dans les guerres civiles: il suffit de se référer aux destructions commises en Europe durant les guerres de Religion, et en France à la fin de la Révolution, sous la Terreur.
On peut donc avancer que le monument, sous des formes variées, existe dans toutes les cultures et sociétés humaines. II apparaît comme un universel culturel. On notera cependant que, dans les sociétés ouest-européennes, le rôle dévolu au monument intentionnel, sous sa forme architecturale, a été concurrencé par le développement des mémoires artificielles à partir de l’invention et de la diffusion de l’imprimerie au XVe siècle. Le destin de l’écriture, première mémoire artificielle, inoubliablement décrite dans le Phèdre de Platon4, sera dès lors porté par l’imprimerie, dont Charles Perrault pointa avec émerveillement le relais qu’elle apporte à la mémoire vivante. Et, dès le XVIIe siècle, les dictionnaires français attestent le déplacement sémantique que la fortune du livre imprimé fait subir au terme «monument»: sa signification mémorielle, première, commence à s’effacer au profit du caractère imposant ou grandiose, attaché à l’adjectif «monumental». À l’époque romantique, la célèbre formule de Victor Hugo «Ceci [l’imprimerie] tuera cela5» annonce la mort de l’architecture en tant que support de la mémoire organique.
Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les sociétés occidentales ont presque cessé d’élever des monuments qui impliquent au présent notre mémoire affective – sauf s’il s’agit d’événements particulièrement traumatiques et/ou mettant en jeu le destin des peuples, comme les génocides du XXe siècle. Et encore, les plus significatifs d’entre eux sont des «reliques». Déjà, après la guerre de 1914, parallèlement aux «monuments aux morts» élevés jusque dans les plus petits villages de France, l’aménagement du champ de bataille de Verdun en fait une vraie relique, devançant le traitement des camps de concentration nazis, tel celui d’Auschwitz.
Le «monument historique» n’est pas un artefact intentionnel, création ex nihilo d’une communauté humaine à des fins mémorielles, il ne s’adresse pas à la mémoire vivante. Il a été choisi dans un corpus d’édifices préexistants en raison de sa valeur pour l’histoire (qu’il s’agisse d’histoire événementielle, sociale, économique ou politique, d’histoire des techniques ou d’histoire de l’art) et/ou de sa valeur esthétique. Plus précisément, dans son


rapport à l’histoire (quelle qu’elle soit), le monument historique se réfère à une construction intellectuelle, il a une valeur abstraite de savoir. En revanche, dans son rapport à l’art, il sollicite la sensibilité esthétique à l’issue d’une expérience concrète. Riegl a, le premier, montré que la coprésence de ces deux types de valeurs était à l’origine d’exigences contradictoires dans le traitement des monuments historiques6.
Loin de lui conférer une universalité comparable à celle du monument intentionnel, sa double relation au savoir et à l’art marque l’indélébile appartenance du monument historique à une culture singulière, celle de l’Europe occidentale, vivifiée depuis le haut Moyen Âge par l’apport arabo-méditerranéen, et dont l’identité, jusqu’à la Réforme et la Contre-Réforme, était fondée sur la compétence théologico-politique de l’Église catholique. C’est sur ce territoire, dans l’Italie du Quattrocento (XVe siècle), qu’a été élaborée la première ébauche du concept de monument historique, ensuite adoptée, développée et collectivement enrichie par l’ensemble des pays ouest-européens. Au fil de cinq siècles, ceux-ci en ont fait le fondement d’une série de pratiques sans précédent hors de ce territoire. On rappellera les grandes étapes de leur développement, issu de deux «révolutions culturelles».
Le moment est donc venu d’aborder ce concept.
La notion de révolution culturelle et les deux étapes de la genèse du monument historique
L’expression «révolution culturelle», désormais adoptée dans le monde entier, a été forgée par le grand historien italien Eugenio Garin. Ce dernier en a aussi élaboré le contenu, à l’occasion précisément de son étude du Quattrocento italien7. II observait que, s’il est habituel de penser la Renaissance du XVe siècle italien en termes d’arts visuels ou d’épistémologie, ces domaines n’en sont pas moins indissociables et solidaires d’un ensemble d’autres innovations (techniques, économiques, politiques...) auxquelles les lient des boucles de rétroaction.
Cependant, Garin ne manquait pas de souligner que le concept de «révolution culturelle» n’est qu’un instrument heuristique. Les discontinuités dont il s’agit ne sont pas inscrites dans le déroulement factuel de l’histoire ouest-européenne. Elles occultent identiquement anticipations et survivances. La Renaissance du Quattrocento ne plonge pas seulement ses racines dans le Trecento de Pétrarque, mais jusqu’aux IXe, XIe et XIIe siècles, à des périodes de l’histoire européenne qu’Erwin Panofsky8 a appelées Renascences, autrement dit «protoRenaissances». Inversement, la révolution industrielle a touché avec un retard considérable de nombreux territoires, notamment français.
Première révolution culturelle européenne: la Renaissance
En ce qui nous concerne ici, le fait essentiel, survenu dans l’Italie du XVe siècle parmi la communauté des lettrés, consiste dans ce qu’Eugenio Garin a appelé le «relâchement» du théocentrisme9, alors partagé par l’ensemble des sociétés chrétiennes ouest-européennes. Ce relâchement n’est pas attribuable à un affaiblissement de la foi religieuse. II marque l’émergence d’un regard neuf sur l’individu humain, jusqu’alors confiné dans le rôle de créature et désormais investi d’un pouvoir créateur. D’où un intérêt nouveau pour l’ensemble des champs de l’activité humaine, qu’ils soient situés dans le présent ou dans le passé. D’où une conception nouvelle de l’histoire comme discipline autonome, sans finalité utilitaire. D’où l’émergence des arts plastiques comme activité esthétique et le statut d’artiste créateur attribué en premier aux architectes par Alberti aux cours des années 1440, et qui ne doit, en aucun cas, être confondu avec la pure et simple projection de leur ego dont se targuent et s’enorgueillissent nos architectes vedettes contemporains.

Dans l’analyse schématique qui suit, je ferai l’impasse sur la spécificité du Rinascimento et de sa poursuite aux XVIe et XVIIe siècles10 pour traiter la Renaissance européenne comme une totalité. Le rôle pionnier joué alors par l’Italie s’explique, non seulement et d’abord, par la prégnance de son héritage romain (en particulier sous la forme d’un dense réseau de villes) mais aussi par des facteurs économiques et politiques liés à la vitalité de ses cités-États. Or, à l’exception de quelques régions germanophones, la plupart des autres pays ouest-européens ont accompli leur propre révolution un bon siècle plus tard.
Quoi qu’il en soit, à partir du XVIe siècle, la première révolution culturelle poursuit son cours dans les pays ouest-européens. Et l’étude des vestiges de l’Antiquité s’étend au reste du bassin méditerranéen.
Qu’il s’agisse alors des bâtiments ou d’autres catégories d’objets, ceux-ci ne sont pas à l’époque appelés «monuments historiques», mais désignés par le substantif pluriel d’antiquités, dérivé du latin antiquitates, forgé par le Romain Varron (116-26 av. J.-C.) pour designer l’ensemble des productions anciennes (langue, usages, traditions...) de la romanité. Selon la même étymologie, les érudits et les savants qui s’appliquent à l’étude des antiquités seront appelés «antiquaires».
Entre le XVIe siècle et les premières décennies du XIXe, les antiquaires européens ont accompli un formidable travail collectif d’inventaire et d’étude concernant toutes les catégories d’antiquités. Issus des milieux lettrés les plus divers (religieux, médecins, artistes, juristes, diplomates, grands seigneurs), ils ont préparé et anticipé les travaux des historiens, des archéologues, des historiens de l’art et des premiers ethnographes du XIXe siècle. À l’issue de relations directes et/ou épistolaires intenses, ils ont contribué à la prise de conscience et au développement de l’unité européenne, dont ils assumaient, dans le même temps, la richesse et la diversité.

La mise en œuvre des informations recueillies par les antiquaires comporte schématiquement trois phases:
1) Jusque vers le dernier quart du XVIIe siècle, à l’exception des architectes antiquaires qui n’ont cessé, depuis le Quattrocento, de relever les monuments et de chercher à reconstituer et à dresser les plans des villes antiques, analyses et descriptions sont surtout présentées sous forme écrite.
2) Pendant le siècle suivant, le texte écrit est accompagné d’une iconographie abondante, sur laquelle il s’appuie. Les quinze tomes de L’Antiquité expliquée (1719-1724) de Bernard de Montfaucon comportent ainsi trente mille figures.
3) Durant les deux dernières décennies du XVIIIe siècle, en grande partie sous l’impact des sciences naturelles et de leur analyse des formes vivantes, le regard des antiquaires (comme celui des archéologues et des premiers historiens de l’art) s’affine: leurs ouvrages manifestent, dans la dialectique du texte et de l’image, une recherche nouvelle d’objectivité scientifique.
Quant à la conservation par les antiquaires de leurs objets d’étude, elle diffère selon la nature des antiquités en cause. En ce qui concerne le cadre bâti, qu’il s’agisse des édifices de l’Antiquité ou de ceux de leurs passés nationaux respectifs, les autorités administratives et les antiquaires européens des XVIIe, XVIIIe siècles et du début du XIXe ne se soucient, en général, pas plus de leur préservation que leurs prédécesseurs de la Renaissance. L’accumulation d’un savoir livresque constitue leur objectif. Exemple: en 1677, à Bordeaux, lors de l’ultime mouvement de fronde, dit de l’Ormée, l’un des plus prestigieux monuments romains demeurés sur notre sol, les «Piliers de Tutelle», fut rasé sur l’ordre de Louis XIV afin d’agrandir le quartier militaire autour de la citadelle du château Trompette. À cette absence de souci conservatoire il faut néanmoins signaler deux exceptions anticipatrices. D’une part, celle des sociétés d’antiquaires anglais: tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, ces derniers ont milité pour la préservation des édifices gothiques, qui, par opposition à l’architecture néoclassique, étaient à leurs yeux l’expression même de leur culture nationale. D’autre part, celle de certains membres des comités et commissions révolutionnaires mis en place sous la Révolution française: Comité d’instruction publique, puis Commission des monuments et Commission temporaire des arts. Non sans conflits internes, est alors élaborée une remarquable méthodologie de la conservation (critères, inventaires), brièvement appliquée, mais abandonnée après Thermidor.
Les antiquités non bâties (médailles, monnaies, peintures, sculptures, etc.) ont, en Italie puis dans le reste de l’Europe, été conservées dans leurs cabinets, sous forme de collections, par les érudits, les artistes et les princes. Ces collections, à ne pas confondre avec les cabinets de curiosités, dont la tradition, médiévale, a duré jusqu’au XIXe siècle, sont les ancêtres des musées, nés au XVIIIe siècle. L’histoire de ces derniers est parallèle à celle des monuments historiques.
La deuxième révolution culturelle
Née, cette fois, en Angleterre durant le dernier quart du XVIIIe siècle, cette révolution culturelle touche ensuite, comme la première, et avec d’analogues décalages et spécificités, l’ensemble des pays ouest-européens. Elle nous est plus familière sous la dénomination de «révolution industrielle». L’expression en souligne la dimension technique, la plus visible: l’avènement du machinisme. Avant de l’aborder sous l’angle réducteur du «monument historique», rappelons qu’à l’instar de la Renaissance cette révolution ne peut être imputée à une seule catégorie de facteurs. Elle tient à un ensemble de causes très diverses dont l’interaction et la solidarité lui ont conféré sa globalité. Comme la révolution de la Renaissance, elle a retenti sur l’ensemble des activités et des comportements sociétaux des pays ouest-européens11: l’avènement du machinisme, accompagné par les développements consécutifs de la production industrielle et des transports ferroviaires, n’a pas seulement provoqué l’exode rural, le bouleversement des milieux de vie traditionnels, la formation du prolétariat urbain, il a aussi contribué à la transformation des mentalités.
Traumatisants et porteurs de nostalgie, les bouleversements et les destructions alors infligés aux territoires urbains et ruraux ont ainsi induit une prise de conscience réactionnelle, qui est sans doute la cause déterminante – mais non la seule – sous l’impulsion de laquelle les pays européens ont institutionnalisé la conservation physique réelle des «antiquités», dès lors promues «monuments historiques». Quant aux autres facteurs en jeu dans cette institutionnalisation, je les évoquerai, pour mémoire et sans prétention à l’exhaustivité, sous quatre chefs, liés aux champs respectifs du savoir, de la sensibilité esthétique, de la technique et des pratiques sociales.
Au plan épistémologique12, le XIXe siècle devient le «siècle de l’histoire», qui se développe dans le cadre des nationalismes européens (voir en France les travaux de François Guizot, Augustin Thierry, Jules Michelet...). L’histoire constitue, en outre, le fondement d’un ensemble de sous-disciplines, dont l’archéologie et l’histoire de l’art, qui élaborent progressivement leur nouveau statut à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Dans le même temps, le romantisme marque l’avènement d’une sensibilité nouvelle à la nature ainsi qu’aux œuvres et vestiges du passé. Le rapport à l’art acquiert une tonalité religieuse. Le goût évolue avec, en particulier, la réhabilitation du Moyen Âge et de l’art gothique. Davantage, tandis que chez les antiquaires, puis lors de l’ouverture au public des premiers musées, la valeur de savoir des œuvres collectionnées ou exposées l’emportait massivement sur leur valeur esthétique, ce rapport s’inverse de façon définitive au cours du XIXe siècle, en faveur de la délectation.
Précédée par la daguerréotypie, la photographie joue désormais un rôle essentiel dans l’appréhension objective des monuments historiques et leur valorisation. D’une part, elle devient un instrument d’analyse complémentaire du dessin, indispensable pour les historiens de l’art et pour les architectes restaurateurs. D’autre part, soutenue par les progrès techniques simultanés de l’imprimerie, elle permet la diffusion de toute l’information iconographique requise sur l’architecture et les monuments historiques.
Enfin, lancé au XVIIIe siècle par l’aristocratie anglaise, le précurseur Grand Tour (dont dérive le mot «tourisme») se répand parmi les classes favorisées de l’Europe. Ainsi naît le «tourisme d’art», dont le développement peut être symbolisé par le nom du Prussien Karl Baedeker (18011859), concepteur et éditeur des premiers guides touristiques focalisés sur les monuments anciens et les musées.

La gestion des monuments historiques: juridiction et restauration, décalages et différences
Le projet de conservation, dont la notion de monument historique n’est pas dissociable, suppose par définition deux instruments spécifiques: d’une part, une juridiction donnant au projet son statut institutionnel; d’autre part, une discipline constructive, solidaire et tributaire des nouveaux savoirs historiques, et dès lors nommée restauration.
Les législations élaborées au sein de l’Europe de l’Ouest pour la protection et la conservation des monuments historiques présentent, elles aussi, des décalages chronologiques dans leur mise en place et des particularités propres aux différents pays concernés, qu’il s’agisse du rôle accordé à l’État, de la nature des procédures adoptées ou des catégories d’édifices composant le corpus desdits monuments. En France, la loi réclamée par le jeune Victor Hugo dès 1825, ébauchée sous forme de décret en 1830, à l’instigation de Guizot, ne voit le jour qu’en 1913. Expression de la centralisation étatique propre à notre pays, géré par une administration d’État, cet instrument juridique se caractérise par la rigueur formelle et la complexité de ses procédures, ainsi que par son vide doctrinal. Ces deux traits contrastent, d’une part, avec l’empirisme régnant en Angleterre, où la gestion des sociétés d’antiquaires et d’archéologues est relayée depuis 1895 par celle d’une association privée, le National Trust, et d’autre part, avec le soubassement théorique propre aux législations des pays germanophones et de l’Italie. C’est à Camillo Boito – ingénieur, architecte et historien de l’art – qu’on doit la loi italienne de 1902, alors la plus avancée d’Europe, Sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d’arte.
De même, sous l’impulsion des Anglais et des Italiens, le corpus des monuments historiques, constitué à l’origine par la seule catégorie des édifices prestigieux (vestiges de l’Antiquité, cathédrales et abbayes, châteaux, palais, hôtels de ville...) antérieurs au XIXe siècle, a intégré des objets chronologiquement plus récents ou typologiquement négligés. Ainsi John Ruskin fut le premier à dire la valeur et à promouvoir la conservation d’un héritage modeste, celui des architectures domestique et vernaculaire qui constituent, en particulier, le tissu des villes anciennes. Quant aux Italiens, dans le sillage tracé par Gustavo Giovannoni13, ils furent les premiers, après la guerre de 1914, à considérer les villes anciennes comme des monuments historiques à part entière. La restauration, grâce aux connaissances livrées à mesure que progressent les savoirs de l’histoire de l’art, de l’histoire des techniques, de l’archéologie..., est la discipline pratique qui entend se substituer aux réparations et interventions – empiriques et marquées au coin de leurs époques respectives – dont, jusqu’alors, tous les monuments et édifices faisaient indistinctement l’objet.
Mais si ces nouveaux savoirs permettent bien l’identification et donc la protection légale des édifices concernés, respectent-ils pour autant le triple statut mémoriel, épistémologique et esthétique du monument historique? La restauration peut-elle faire fi de la durée, dans laquelle sont identiquement engagés les humains et leurs créations ? Riegl, encore lui, a proposé une interprétation relativiste de cette discipline fondée sur son analyse des valeurs contradictoires dont tout monument historique est porteur. Il a ainsi démontré qu’en matière de restauration il ne peut exister aucune règle absolue, chaque cas s’inscrivant dans une dialectique particulière des valeurs en jeu14.
Néanmoins, depuis l’invention du monument historique, la légitimité de la restauration n’a cessé d’être mise en question dans l’affrontement de deux camps, conservateur et interventionniste, vite symbolisés par deux pays, l’Angleterre et la France, et par deux noms associés respectivement à deux formules: Ruskin («Ce qu’on nomme restauration est la pire forme de destruction que puisse subir un bâtiment15») et Viollet-le-Duc («Restaurer un édifice [...] c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé16»). J’ai pu montrer, textes à l’appui, qu’il s’agissait là d’une opposition artificielle qui masque un profond accord sur le statut et le sens du monument historique dans le cadre de la culture ouest-européenne17.
En dépit de questionnements multiples et contradictoires sur les modalités de la restauration, le statut du monument historique et les vocables qui le désignent dans les différentes langues de l’Europe occidentale demeuraient bien vivants et le terme «patrimoine» était complètement exclu de ce champ. En témoignent les deux premières conférences internationales sur la conservation des monuments historiques, respectivement tenues à Athènes (1931) et à Venise (1964), dont les par
En dépit de questionnements multiples et contradictoires sur les modalités de la restauration, le statut du monument historique et les vocables qui le désignent dans les différentes langues de l’Europe occidentale demeuraient bien vivants et le terme «patrimoine» était complètement exclu de ce champ. En témoignent les deux premières conférences internationales sur la conservation des monuments historiques, respectivement tenues à Athènes (1931) et à Venise (1964), dont les participants (archéologues, historiens de l’art, architectes, conservateurs) étaient tous d’origine européenne.

L’apparition du patrimoine
Le terme «patrimoine», assorti de l’adjectif «culturel», a été lancé par André Malraux dans un cadre strictement national. Il s’agissait pour lui de valoriser l’«exception culturelle française18». Mais en confondant sous ce vocable les concepts de monument et de monument historique, il adoptait une position populiste. En effet, critiquant le statut élitiste qui caractérisait le public des monuments historiques19 au lieu de l’assortir d’une politique d’éducation, il reprenait, par abus de langage, la position énoncée en 1936 par le Front populaire dans le cadre du droit au travail et affirmait: «Il n’y aurait pas de culture s’il n’y avait pas de loisirs20.»
En résonance avec l’«exception française», le vocable «patrimoine» et l’institution corrélative d’un ministère de la Culture se répandirent rapidement en Europe. Mais sans conséquences notables. Ainsi, l’Italie poursuivit non seulement sa tradition de réutilisation vivante des monuments, mais surtout sa politique éducative alors unique au monde: édition par l’État de manuels (sans équivalents même dans les universités françaises) sur les arts visuels et, en particulier, sur l’architecture et les différents établissements humains, à l’appui de cours obligatoires donnés dès l’école primaire, mais aussi durant les trois dernières années des écoles secondaires et dans les écoles techniques.
L’intervention de l’UNESCO
D’une autre importance sémantique et symptomatique est la publication, en 1972, par l’UNESCO, de la «Convention du patrimoine mondial, naturel et culturel». L’amalgame des deux notions de «monument» et de «monument historique» est ainsi entériné, attribuant à «patrimoine» le statut d’universel culturel, et occultant, du même coup, la fonction symbolique du monde édifié ainsi que le processus permanent d’enrichissement et de différenciation de nos cultures, comme marqueurs de l’espèce humaine. Le message lancé, dès 1952, par Claude Lévi-Strauss était pourtant clair: «Il n’y a pas, et il ne peut y avoir, une civilisation mondiale [...] puisque la civilisation implique la coexistence de cultures offrant entre elles le maximum de diversités, et consiste même en cette coexistence21.»Les pays de la communauté mondiale signataires de ladite Convention seront assistés par le Centre du patrimoine mondial, dont les experts leur apporteront l’aide technique et économique nécessaire à l’identification et à l’entretien de leur patrimoine mondial; d’autre part, il revient au même Centre d’attribuer le label «patrimoine mondial» symbole de ce statut.
Cette labellisation entraîne, de facto, un processus de muséification dont l’accélération induit une marchandisation planétaire – ce n’est pas un hasard si le Centre du patrimoine mondial a obtenu en 2008 le prix mondial du Tourisme. Non seulement les patrimoines labellisés sont équipés de commerces divers: vente de souvenirs importés du monde entier, commerces de bouche... Mais surtout ils attirent des parcs d’attractions, des structures d’hébergement, une prolifération de pastiches ou même de faux. Tout cet appareil normalisé et identique à travers la planète porte atteinte à la fois à l’environnement et à la culture propre des pays concernés.
L’intérêt symptomatique du terme «patrimoine», dans son acception et sa diffusion actuelles, est de nous confronter à une révolution sans commune mesure avec les révolutions culturelles propres à la culture occidentale: concernant la totalité des cultures humaines, elle met en cause leur statut anthropologique. En raison de son étiologie technique, j’ai choisi de la nommer révolution électro-télématique22.
La révolution électro-télématique
Cette dénomination tient en effet compte de ses deux facteurs dominants: le développement de l’informatique et celui, qui en dépend étroitement, des grands réseaux de transport, hors d’échelle, dont la résille couvre désormais notre planète.
Comme toute révolution technique, la révolution électro-télématique exerce un impact direct sur l’ensemble des comportements sociétaux, auxquels les lient des boucles de rétroaction. Emblématique est la position, désormais régalienne, de la «techno-science», qui, sous le vocable fallacieux de technologie, assimile et confond les deux concepts de science et de technique.
De façon nécessairement réductrice et schématique, mais à l’aide de néologismes expressifs, j’évoquerai quelques-uns des effets culturels de la révolution électro-télématique:
– dédifférenciation: en particulier appauvrissement ou même, dans certaines contrées, disparition des langues vivantes au profit d’un sabir, en majeure partie dérivé de l’anglo-américain. Dans l’Europe de l’Ouest, cet appauvrissement n’en est pas moins spectaculaire, touchant, dans chaque cas, la spécificité de la langue concernée (syntaxe du français, richesse terminologique de l'anglais...);
– détemporalisation: vie dans une immédiateté qui nie la fonction créatrice de la durée;
– décorporéisation: triomphe du monde virtuel et perte de contact avec le monde de la terre et des vivants que les humains appréhendent au moyen de tous leurs sens: vision, odorat, toucher, audition et goût. Cette méconnaissance est confirmée et encouragée par l’UNESCO avec sa labellisation «patrimoine immatériel de l’humanité», représenté par des pratiques matérielles et parfaitement sensibles: récits, chants et danses traditionnels locaux ou même, plus récemment, en 2010, la cuisine locale, ainsi muséifiée et offerte à la consommation touristique;
– désinstitutionalisation: réduction des relations humaines qui fondent la culture par Ies contacts humains directs.
Vers le posthumain ou la singularité
Au plan de la spatialité qui nous concerne ici, on peut d’orès et déjà attribuer à la révolution électro-télématique les effets suivants:
– disparition d’un lexique pertinent applicable aux établissements humains;
– remplacement des anciennes disciplines d’aménagement (architecture et urbanisme) au profit d’un urbanisme de branchement23;
– élimination des praticiens traditionnels engagés dans un rôle de passeurs et effacement corrélatif de la pratique du dessin manuel, remplacé par la CAO (conception assistée par ordinateur);
– apparition des architectes et/ou urbanistes vedettes focalisés (voir leurs plans et iconographies) sur l’espace de circulation au détriment des espaces d’usage;
– méconnaissance croissante de la fonction symbolique de l’édification, que j’ai appelée compétence d’édifier24: Et je rappellerai ici que ce rôle symbolique ne revient pas seulement aux édifices à fonction mémorielle (monuments), mais bien aussi à toutes les œuvres matérielles édifiées non consciemment, tels les paysages et les équipements les plus humbles. Voir à ce sujet ce qu›en ont écrit, au moyen des concepts disponibles à leurs époques respectives, des auteurs comme Leon Battista Alberti ou John Ruskin, pour ne citer que les plus grands.
À terme, selon les craintes de quelques visionnaires, les prévisions de certains futurologues et les vœux de certains technolâtres, cette évolution vers un espace abstrait pourrait bien aboutir à la disparition de notre espèce au profit de ce qui fut d’abord nommé explicitement le posthumain25 puis aujourd’hui la singularité – le dernier terme dérivant de la désinstitutionalisation de nos sociétés au profit des libertés individuelles, singulières, offertes par la virtualisation du monde. Depuis la parution en 2005 de son livre The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology26, Ray Kurzweil27 dirige le Singularity Institute for Artificial Intelligence, mais il ne cherche pas pour autant à dissimuler le problème éthique posé par cette singularité. Pour finir sur une comparaison plus réjouissante, le statut de nos remplaçants serait alors analogue à celui des êtres virtuels décrits par Villiers de L’Isle-Adam dans son roman L’Ève future.
Que faire?
Cette analyse catastrophiste répond au même parti rhétorique que celui de Gunther Anders28: il est destiné à faire mesurer, par une prise de conscience, les risques inhérents à la globalisation. L’intérêt que je porte au patrimoine bâti ne doit en aucune façon être interprété comme une marque de passéisme. Si je dénonce la muséification des monuments et monuments historiques, c’est afin de les réintroduire dans la vie d’aujourd’hui. Et si je m’insurge contre ce que Giorgio Ferraresi nomme, avec pertinence, la «dictature de la raison instrumentale29», c’est pour reconnaître pleinement la valeur de l’informatique en tant que précieux instrument technique.
On trouve, en effet, les signes d’un combat possible contre le processus qui menace notre espèce dès les années 1970, où les conséquences de la globalisation deviennent mieux perceptibles. De nombreux praticiens – connus ou inconnus – entreprennent alors un travail qui se développe dans la durée, à mesure de leur expérience.
À titre emblématique, je citerai ici un nom: celui de l’architecte-urbaniste et historien Rogelio Salmona (1927-2007). Jusqu’à son dernier jour, sans relâche, Salmona poursuivit et développa son travail sur le sol de la Colombie. En associant les techniques de pointe à l’écoute des populations, à une prise en compte toujours plus attentive des sols, des reliefs, des végétaux, des ciels et de l’ancien cadre bâti, il a édifié une œuvre semblable à aucune autre aujourd’hui parce qu’elle affirme avec lyrisme, en même temps que notre modernité, l’identité, l’altérité et les différences d’une culture30.


Mais on trouve aussi des noms exemplaires parmi les générations suivantes. Sans pouvoir échapper à l’arbitraire d’une sélection, j’évoquerai le travail convergent et spectaculaire, accompli dans la durée jusqu’aujourd’hui, au tour d’Alberto Magnaghi en Italie31 et de JeanMarie Billa32 en France. Leur double travail, enrichi par des échanges vécus sur place, présente les caractéristiques suivantes:
– primauté du territoire et de l’échelle locale;
– exclusion du tourisme au profit des habitants locaux;
– exclusion de tout «communautarisme», l’identité locale étant représentée par les individus et les familles qui habitent et qui travaillent sur les lieux: qu’il s’agisse d’immigrants de même nationalité ou d’étrangers, y compris gens du voyage, ainsi sédentarisés;
– participation directe de ces «communautés locales» à toutes les décisions et actions les concernant.
L’avenir
Certes, on pourrait encore citer quelques exemples récents, tel le refus du label «patrimoine mondial» en 2010 par le maire d’Albi, Philippe Bonnecarrère.
L’optimisme conforté par les démarches que je viens de décrire semble cependant aujourd’hui dangereusement compromis par le développement asymptotique des techniques de virtualisation, par le cloisonnement croissant des savoirs au détriment de leur solidarité globale, mais surtout par la politisation croissante de tous les domaines de la culture, qu’il s’agisse de l’économie, de l’aménagement des territoires ou de l’enseignement: mais la «politique» étant désormais entendue à l’inverse du sens initial, démocratique et fondateur, qu’Aristote donna à ce terme. Ainsi, nos voisins italiens, à dessein cités plus haut, se voient désormais privés d’accès à leur travail «territorialiste» tandis qu’au sein de leurs universités un cinquième de leurs postes ne sont plus renouvelés.
C’est bien pourquoi, dans un moment où il est devenu vital, pour les sociétés humaines, de redécouvrir la réalité des territoires, autrement dit leur double et indissociable appartenance aux mondes de la nature et de la culture, si parfaitement explicitée par Claude Lévi-Strauss au fil de son œuvre, depuis 194833. Je livre au lecteur quelques passages clefs du manifeste territorialiste lancé en 2010-2011 sous l’égide d’Alberto Magnaghi.

[...] Face aux défis que la méconnaissance des territoires et de l’échelle locale nous imposent aujourd’hui pour la sauvegarde de notre identité humaine, des enseignants et des chercheurs appartenant à de nombreuses universités italiennes, de Turin à Venise et de Milan à Palerme, ont fondé la Société des territorialistes. Cette dénomination est empruntée à l’anglais Patrick Geddes qui, dans le cadre de la révolution industrielle, avait créé une association de défense des lieux, dite Société Le Play (1806-1882), en hommage à l’économiste français34. [...]
La Société des territorialistes est une association autonome ouverte aux chercheurs du monde entier qui partagent les mêmes valeurs [...] et qu’elle entend constituer en réseaux, réunir annuellement et doter d’une revue.
La Société des territorialistes a pour objectif l’élaboration d’une démarche globale transdisciplinaire: qu’il s’agisse de la physique, des sciences de la nature et de la vie; qu’il s’agisse des sciences humaines et de l’anthropologie; ou qu’il s’agisse des pratiques (artisanats, architecture, aménagement) ou des techniques (y compris informatiques) liées à l’édification de notre cadre de vie. [...]
Sous les coulées de lave de l’urbanisation contemporaine, survit un patrimoine territorial d’une extrême richesse, prêt à une nouvelle fécondation, par des nouveaux acteurs sociaux capables d’en prendre soin comme d’un bien commun. Le processus est désormais en voie d’émergence. [...]
*
Notes

